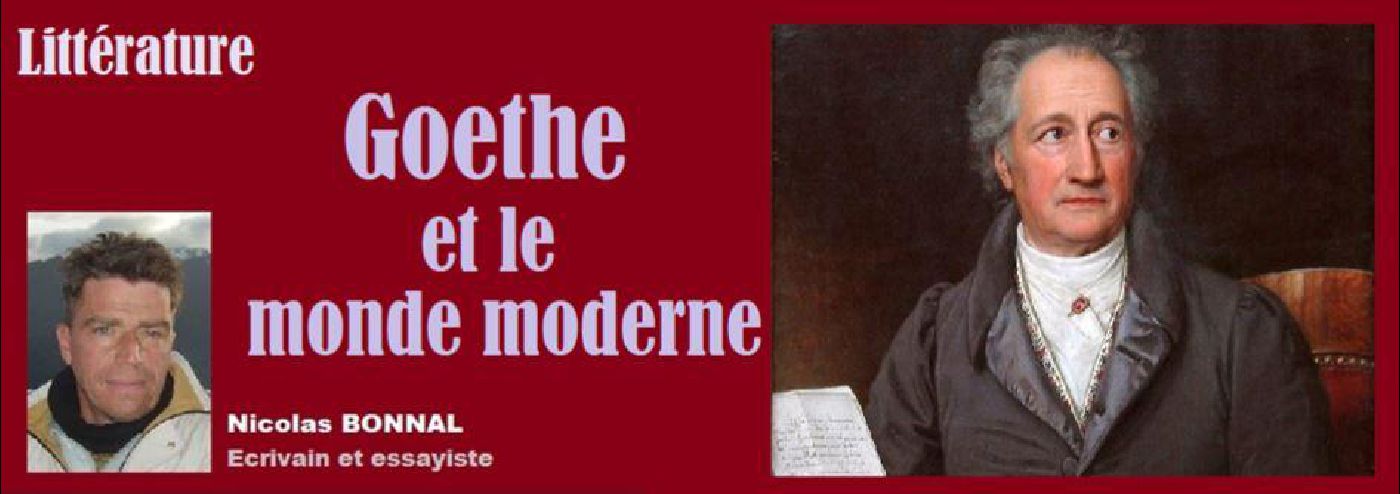
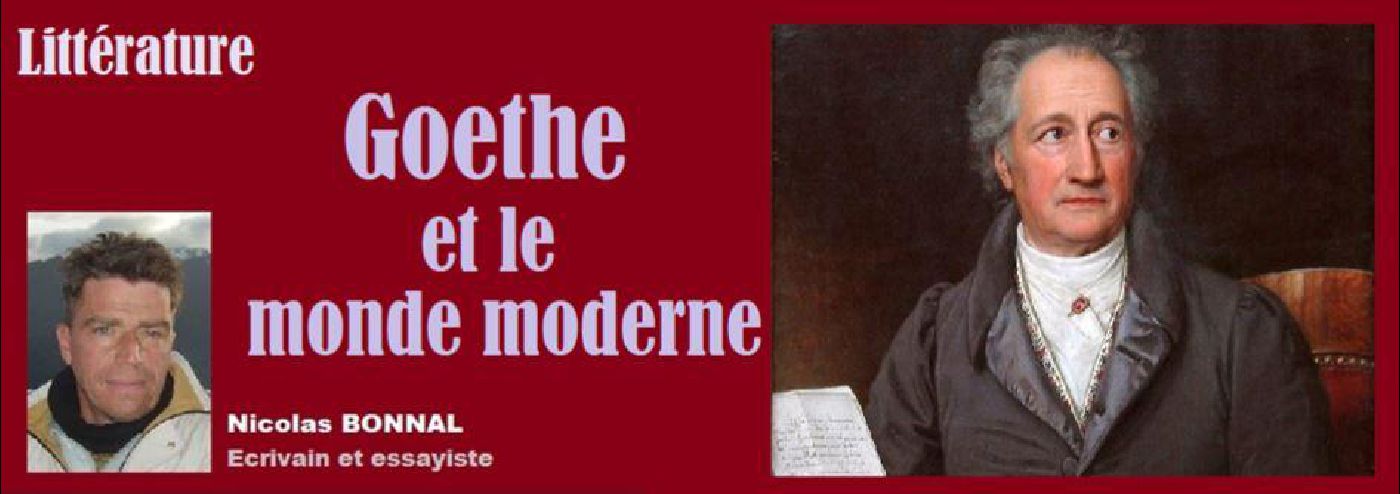
« Les apôtres de liberté m’ont toujours été antipathiques, car ce qu'ils finissent toujours par chercher, c'est le droit pour eux à l'arbitraire. »
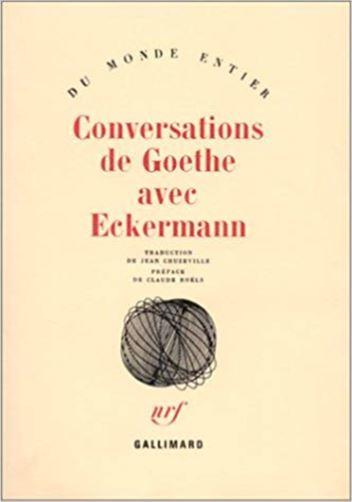
« Celui qui ne veut pas croire qu'une grande partie de la grandeur de Shakespeare est due à la grandeur et à la puissance de son siècle, que celui-là se demande si l'apparition d'un phénomène aussi étonnant serait possible aujourd'hui dans l'Angleterre de 1824, dans nos jours détestables de journaux à critiques dissonantes ? Ces rêveries tranquilles et innocentes, pendant lesquelles il est seul possible de créer quelque chose de grand, sont perdues pour jamais ! Nos talents aujourd'hui doivent tout de suite être servis à la table immense de la publicité. Les revues critiques qui chaque jour paraissent en cinquante endroits, et le tapage qu'elles excitent dans le public, ne laissent plus rien mûrir sainement. »

« Celui qui aujourd'hui ne se retire pas entièrement de ce bruit, et ne se fait pas violence pour rester isolé, est perdu. Ce journalisme sans valeur, presque toujours négatif, ces critiques et ces discussions répandent, je le veux bien, une espèce de demi-culture dans les masses ; mais pour le talent créateur, ce n’est qu’un brouillard fatal, un poison séduisant qui ronge les verts rameaux de son imagination, la dépouille de son brillant feuillage, et atteint jusqu'aux profondeurs où se cachent les sucs vitaux et les fibres les plus délicates. »
« Et puis la vie elle-même, pendant ces misérables derniers siècles, qu'est-elle devenue ? Quel affaiblissement, quelle débilité, où voyons-nous une nature originale, sans déguisement ? Où est l'homme assez énergique pour être vrai et pour se montrer ce qu'il est ? Cela réagit sur les poètes ; il faut aujourd'hui qu'ils trouvent tout en eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus rien trouver autour d'eux. »
« Et osez dire après cela que les sources de vie n’ont pas été affaiblies, troublées, sous cette « étoile », sous ce réseau dans lequel les hommes se sont empêtrés.
Et ne croyez pas m’en imposer par votre prospérité, par vos richesses, par la rareté des disettes et par la rapidité des moyens de communication ! Les richesses sont plus abondantes, mais les forces déclinent ; il n’y a plus de pensée qui crée un lien entre les hommes ; tout s’est ramolli, tout a cuit et tous sont cuits ! Oui, tous, tous, tous nous sommes cuits !… »
« Nous causâmes alors de l'unité de l'Allemagne, cherchant comment elle était possible et en quoi cite était désirable. »
« Je ne crains pas que l’Allemagne n'arrive pas à son unité, dit Goethe nos bonnes routes et les chemins de fer qui se construiront feront leur œuvre. Mais, avant tout, qu'il y ait partout de l'affection réciproque, et qu'il y ait de l'union contre l'ennemi extérieur. »
« Qu'elle soit une, en ce sens que le thaler et le silbergroschen aient dans tout l'empire la même valeur ; une, en ce sens que mon sac de voyage puisse traverser les trente-six États sans être ouvert ; une, en ce sens que le passeport donné aux bourgeois de Weimar par la ville ne soit pas à la frontière considéré par remployé d'un grand État voisin comme nul, et comme l'égal d'un passeport étranger… »
« Que l'on ne parle plus, entre Allemands, d'extérieur et d’intérieur ; que l'Allemagne soit une pour les poids et mesures, pour le commerce, l'industrie, et cent choses analogues que je ne peux ni ne veux nommer. »
« Mais si l'on croit que l'unité de l'Allemagne consiste à en faire un seul énorme empire avec une seule grande capitale, si l'on pense que l'existence de cette grande capitale contribue au bien-être de la masse du peuple et au développement des grands talents, on est dans l'erreur. »
« Ce serait un bonheur pour la belle France si, au lieu d'un seul centre, elle en avait dix, tous répandant la lumière et la vie… »
« Où est la grandeur de l'Allemagne, sinon dans l'admirable culture du peuple, répandue également dans toutes les parties de l’empire ? Or, cette culture n'est-elle pas due à ces résidences princières partout dispersées ; de ces résidences part la lumière, par elles elle se répand partout… »

« Pensez à ces villes comme Dresde, Munich, Stuttgart, Cassel, Brunswick, Hanovre, et à leurs pareilles, pensez aux grands éléments de vie que ces villes portent en elles ; pensez à l’influence qu'elles exercent sur les provinces voisines et demandez-vous ; tout serait-il ainsi, si depuis longtemps elles n'étaient pas la résidence de princes souverains ? »

« Francfort, Brème, Hambourg, Lubeck sont grandes et brillantes ; leur influence sur la prospérité de l’Allemagne est incalculable. Resteraient-elles ce qu'elles sont, si elles perdaient leur indépendance, et si elles étaient annexées à un grand empire allemand, et devenaient villes de province ? J'ai des raisons pour en douter… »
« …mais il y a dans les Anglais quelque chose que la plupart des autres hommes n'ont pas. Ici, à Weimar, nous n'en voyons qu'une très petite fraction, et ce ne sont sans doute pas le moins du monde les meilleurs d'entre eux, et cependant comme ce sont tous de beaux hommes, et solides. »

« Ce qui les distingue, c'est d'avoir le courage d'être tels que la nature les a faits. II n'y a en eux rien de faussé, rien de caché, rien d'incomplet et de louche ; tels qu'ils sont, ce sont toujours des êtres complets. Ce sont parfois des fous complets, je t'accorde de grand cœur ; mais leur qualité est à considérer, et dans la balance de la nature elle pèse d'un grand poids. »
« Du reste, nous autres Européens, tout ce qui nous entoure est, plus ou moins, parfaitement mauvais ; toutes les relations sont beaucoup trop artificielles, trop compliquées ; notre nourriture, notre manière de vivre, tout est contre la vraie nature ; dans notre commerce social, il n'y a ni vraie affection, ni bienveillance. »

« On souhaiterait souvent d'être né dans les îles de la mer du Sud, chez les hommes que l'on appelle sauvages, pour sentir un peu une fois la vraie nature humaine, sans arrière-goût de fausseté. »
« Quand, dans un mauvais jour, on se pénètre bien de la misère de notre temps, il semble que le monde soit mûr pour le jugement dernier. Et le mal s'augmente de génération en génération. Car ce n'est pas assez que nous ayons à souffrir des péchés de nos pères, nous léguons à nos descendants ceux que nous avons hérités, augmentés de ceux que nous avons ajoutés… »
« Notre population des campagnes, en effet, répondit Goethe, s'est toujours conservée vigoureuse, et il faut espérer que pendant longtemps encore elle sera en état non seulement de nous fournir des cavaliers, mais aussi de nous préserver d'une décadence absolue ; elle est comme un dépôt où viennent sans cesse se refaire et se retremper les forces alanguies de l'humanité. Mais allez dans nos grandes villes, et vous aurez une autre impression… »
« Causez avec un nouveau Diable boiteux, ou liez-vous avec un médecin ayant une clientèle considérable - il vous racontera tout bas des histoires qui vous feront tressaillir en vous montrant de quelles misères, de quelles infirmités souffrent la nature humaine et la société… »

En sorte, dis-je un peu rêveur, qu’il nous faudrait de nouveau manger du fruit de l’arbre de la connaissance, pour retomber dans l’état d’innocence ?
— Sans nul doute, répondit-il ; c’est le dernier chapitre de l’histoire du monde.
« Ah ! nous autres modernes, nous sentons bien la grande beauté des sujets d'un naturel aussi pur, aussi complètement naïf ; nous savons bien, nous concevons bien comment on pourrait faire quelque chose de pareil, mais nous ne le faisons pas ; on sent la réflexion qui domine, et nous manquons toujours de cette grâce ravissante… »
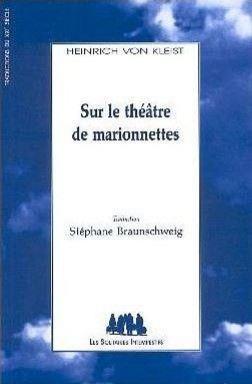
« Je dis que je savais fort bien quels désordres produit la conscience dans la grâce naturelle de l’homme. Un jeune homme de ma connaissance avait, par une simple remarque, perdu pour ainsi dire sous mes yeux son innocence et jamais, dans la suite, n’en avait retrouvé le paradis, malgré tous les efforts imaginables. »
« Les objets ne font que paraître et disparaître à mes yeux, et je me demande souvent si mon existence elle-même n’est pas un vain prestige. Il me semble que j’assiste à un spectacle de marionnettes. Je vois passer et repasser devant moi de petits bons hommes, de petits chevaux, et je me demande souvent si tout cela n’est pas une illusion d’optique. Je joue avec ces marionnettes, ou plutôt je ne suis moi-même qu’une marionnette. Quelquefois je prends mon voisin par la main, je sens qu’elle est de bois, et je recule en frissonnant. »
« Mais, entre nous, l’homme qui cédant sottement à l’influence d’autrui, sans goût personnel, sans nécessité, consume sa vie dans de pénibles travaux pour un peu d’or, de vanité, ou quelque autre semblable fumée, cet homme-là est à coup sûr un imbécile ou un fou. »
« Mais ce qui est sûr, c'est que, si on réussit à percer un canal tel qu'il puisse donner passage du golfe du Mexique dans l’Océan Pacifique à des vaisseaux de toute charge et de toute grosseur, ce fait aura d'incalculables résultats et pour le monde civilisé et pour le monde non civilisé. Je m'étonnerais bien que les États-Unis manquassent de se saisir d'une œuvre pareille. On pressent que ce jeune État avec sa tendance décidée vers l'Ouest, aura aussi pris possession, dans trente ou quarante ans, des grandes parties de terre situées au-delà des montagnes Rocheuses, et les aura peuplées… »
« On pressent aussi bien que tout le long de cette cote de l'océan Pacifique où la nature a déjà creusé les ports les plus vastes et les plus sûrs, se formeront peu à peu de très-importantes villes de commerce, qui seront les intermédiaires de grands échanges entre la Chine et l'Inde d'un côté et les États-Unis de l’autre… »
« Aussi, je le répète, il est absolument indispensable pour les Etats-Unis d'établir un passage entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, et je suis sûr qu'ils l'établiront. Je voudrais voir cela de mon vivant, mais je ne le verrai pas. Ce que je voudrais voir aussi, c'est l’'union du Danube et du Rhin… »
« Et enfin, en troisième lieu, je voudrais voir les Anglais en possession d'un canal à Suez. »
Saisissez votre adresse mail dans l'espace ci-dessous : c'est gratuit et sans engagement
Partager cette page